Le Civam accompagne les projets de transmission
Émeline Jarnet vient de fêter ses vingt ans au sein du Civam 35 Installation Transmission. On peut dire que le milieu paysan bretilien, elle en connaît un bon morceau. C’est elle qui accompagne les projets de transmission de fermes en facilitant les liens entre les paysan·nes qui cèdent leur ferme et ceux et celles qui souhaitent s’installer. Nous l’avons rencontrée.
Les Civam accompagnent le maintien des fermes sur les territoires. Pour vous, quels sont les enjeux de la transmission des fermes aujourd’hui ?
Le constat aujourd’hui, c’est que la moitié des agriculteurs et agricultrices vont partir en retraite dans moins de dix ans. Il y a beaucoup de terres qui se libèrent. Et la réalité, c’est qu’on compte une installation pour trois départs. Il y a urgence parce que, si elles ne sont pas reprises, les fermes partent à l’agrandissement. Or l’agrandissement se fait majoritairement en conventionnel, c’est-à-dire avec usage de pesticides et d’intrants chimiques. Les études nous disent que plus y a de transmission par l’agrandissement, plus il y a utilisation de produits phytosanitaires. Maintenir des fermes à taille humaine en polyculture élevage, c’est aussi répondre aux enjeux de l’eau en Ille-et-Vilaine.
Dans le répertoire des départs de la Chambre d’agriculture, ce sont surtout des petites fermes qui sont à reprendre. Et aujourd’hui, des candidat·es à l’installation avec des projets d’agriculture et d’alimentation durable, il y en a. Mais si le vivier est important, il n’est pas suffisant. Ce sont souvent des personnes non issues du milieu agricole et le parcours est très long. Souvent, elles en sont au stade du rêve, ont besoin de clarifier, de se former, de tester. C’est un processus long.
Il faut que les paysannes et paysans qui ont travaillé dur toute leur vie puissent prendre leur retraite et il faut éviter l’agrandissement. Ce sont deux enjeux importants de la transmission.
Quelles sont les questions qu’un·e paysan·ne se pose au moment d’envisager la retraite ?
Le premier déclencheur, c’est la durée d’un prêt agricole ou parfois un souci de santé. Les paysannes et paysans font évoluer leur ferme pendant toute leur carrière. Quand ils et elles se posent la question de réparer ou renouveler la salle de traite par exemple, ils et elles regardent quand le prêt sera remboursé. Face au dernier investissement sur la ferme, ils et elles se retrouvent face à la question de la transmission. C’est souvent à ce moment-là que les questions arrivent. Est-ce que mes enfants vont reprendre ? Est-ce que ma ferme est transmissible ? Comment s’y prendre ?
Pour certain·es, c’est un peu vertigineux.
La transmissibilité c’est un gros sujet, on a fait deux études pour comprendre pourquoi certain·es n’imaginent pas que leur ferme sera transmissible. Il y a du défaitisme. Et aussi le fait que les paysans et paysannes n’ont pas conscience qu’il y a un public pour ça : des porteurs et porteuses de projets prêt·es à reprendre les petites fermes. On travaille à repérer les petites et moyennes fermes pour lever les freins. Je fais du porte-à-porte. Je vais à leur rencontre à l’improviste. J’essaye de rentrer en discussion, de semer l’idée qu’un jour il faudra transmettre. On discute de comment ils se projettent, on identifie les points forts de la ferme, on crée un lien de confiance.
La transmission, ça s’anticipe. C’est du temps long. On identifie quatre étapes : la première pensée, l’émergence de la réflexion, la construction du projet et la transmission-reprise qui est une phase de co-construction avec le repreneur ou la repreneuse. Notre mission est d’accompagner ce cheminement tout du long.
Comment faites-vous pour accompagner le passage de relais d’un·e paysan·ne qui transmet à un·e jeune qui s’installe ?
Nous organisons chaque année une formation à destination des cédant·es. Ce sont six journées échelonnées de novembre à mars qui les mettent en démarche projet. Se poser les bonnes questions, chiffrer, connaître les aspects sociaux et juridiques, transmettre du foncier… il y a beaucoup de thématiques à aborder. La troisième journée, on invite des candidat·es à la reprise, cela permet aux cédant·es et aux candidat·es de confronter leurs problématiques respectives. Et puis pour la sixième journée, on fait venir une psychologue pour travailler les aspects humains de la transmission. Quand on transmet, il y a une forme de deuil, de crise. Parfois, le ou la cédante est le maillon qui casse la transmission familiale de génération en génération. Ce n’est pas facile à accepter, c’est un poids parfois lourd à porter. L’enjeu humain est très important.
On accompagne aussi les binômes cédant·e/repreneur·euse, on construit l’accompagnement en fonction des besoins, de la temporalité des personnes, on s’adapte au cas par cas. Par exemple, Paul et Thomas avaient besoin de s’offrir un temps avec un personne extérieure pour lister toutes les tâches administratives, l’évaluation de la ferme, les investissements, la rencontre des propriétaires pour continuer les baux… À chaque rendez-vous, les choses s’affinent. J’ose poser les questions que l’un ou l’autre pourrait ne pas oser poser. Je fais de la facilitation. Ils construisent ensemble. Anticiper et co-construire, ce sont les gages de réussite d’une transmission.
Le Civam 35 Installation-Transmission est une association d’éducation populaire qui emploie cinq salariées et est administrée par une quinzaine de personnes – paysan·nes, retraité·es, porteurs et porteuses de projets, citoyens et citoyennes – toutes engagées pour accompagner la transmission et l’installation de fermes paysannes en Ille-et-Vilaine et renouveler les générations en agriculture.
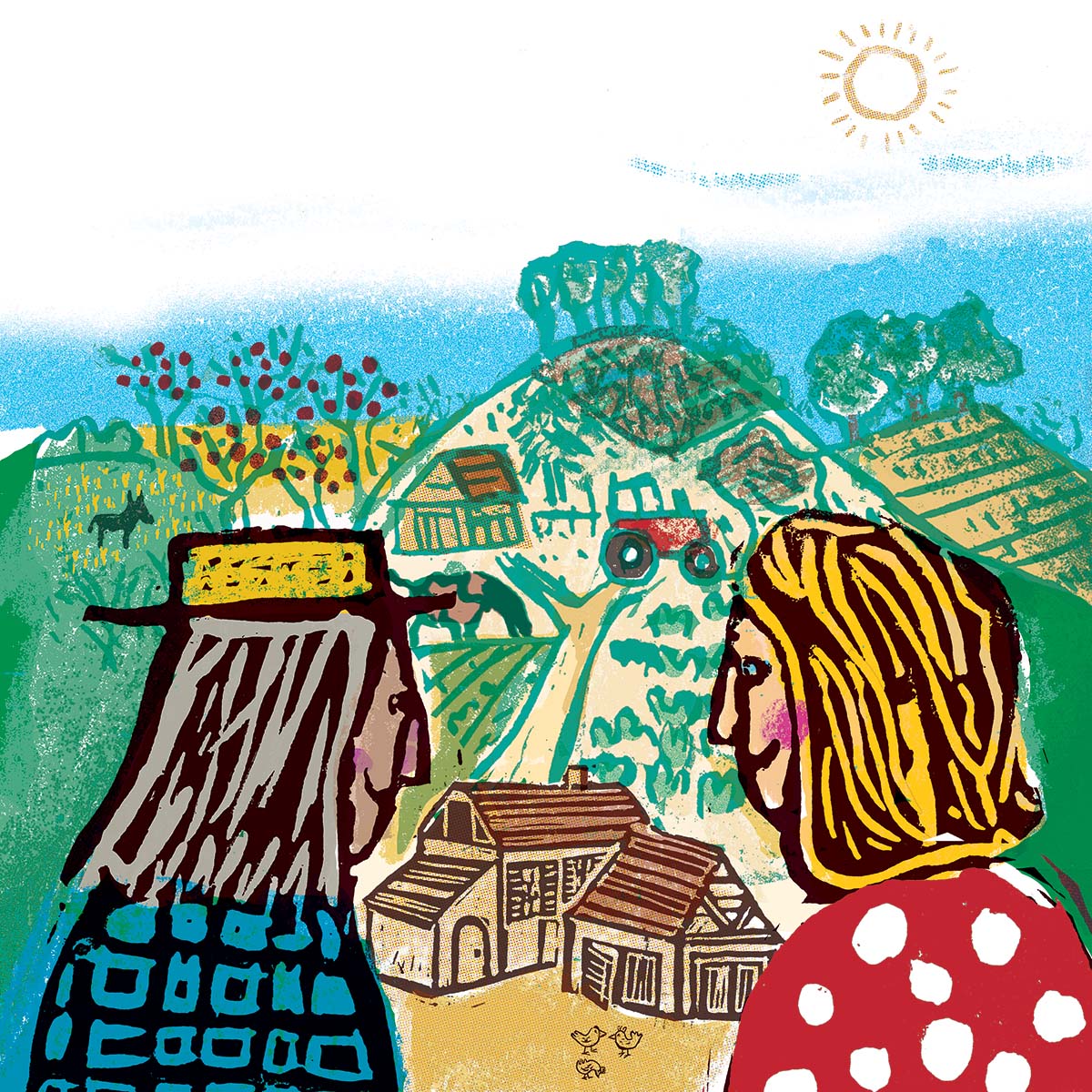
décryptage
La clé des champs
Alors que la moitié de la population agricole partira à la retraite d’ici dix ans et que les fermes dont de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes, comment fait-on pour maintenir une agriculture paysanne à taille humaine ? C’est tout l’enjeu de la transmission des fermes. Lire notre dossier