La clé des champs
Alors que la moitié de la population agricole partira à la retraite d’ici dix ans et que les fermes sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes, comment fait-on pour maintenir une agriculture paysanne à taille humaine ? C’est tout l’enjeu de la transmission des fermes.
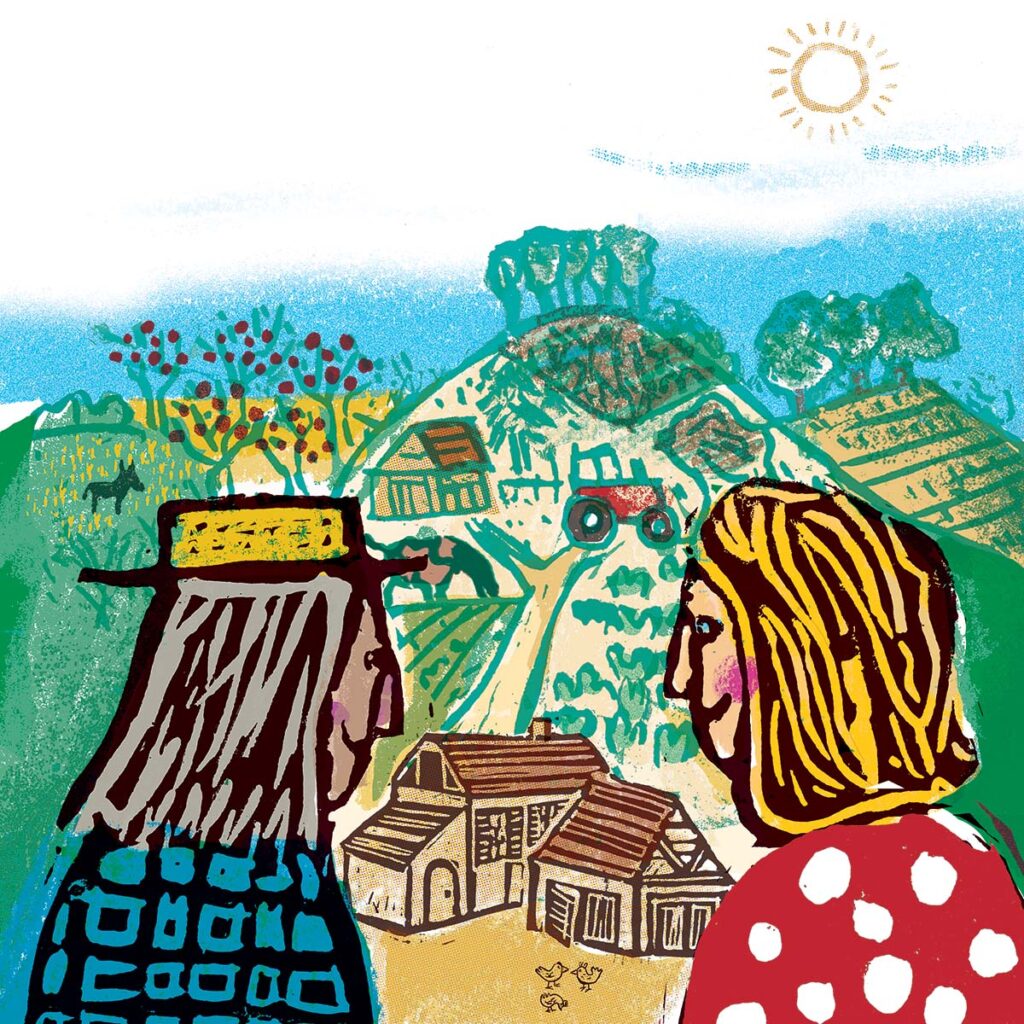
Près de la moitié des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite d’ici dix ans. Chaque année, vingt mille chef·fes d’exploitation prennent leur retraite et seulement quatorze mille s’installent. Pourtant, la surface agricole n’évolue pas. En réalité, la taille des exploitations ne cesse d’augmenter. Entre une agriculture de propriétaires fonciers et de firmes et une agriculture issue du remembrement, nourrie aux engrais et aux pesticides, contraignant les exploitants à investir toujours plus – et à s’endetter par la même occasion – il existe pourtant une voie. Celle d’une agriculture paysanne à taille humaine.
Assurer le renouvellement des générations de paysan·nes et le maintien de fermes à taille humaine est une condition pour pouvoir continuer à nous nourrir de manière durable pour la santé humaine et la préservation de l’environnement. Comment fait-on pour maintenir des petites fermes favorables à la biodiversité, à la qualité de l’air, de l’eau et rémunératrices pour les paysannes et paysans ? C’est tout l’enjeu de la transmission des fermes.
Il était une fois un paysan qui avait travaillé toute sa vie
C’est l’histoire d’un petit paysan bio. Mettons qu’il s’appelle François, il a la soixantaine passée et ses enfants qui ont grandi avec le XXIe siècle naissant n’ont pas souhaité reprendre la ferme familiale. Après quarante-cinq ans à travailler aux champs, à avoir fait évoluer la ferme qu’il tenait de ses parents, la convertissant en agriculture biologique, mécanisant les pratiques pour préserver le corps, faisant évoluer les cultures et les méthodes, François doit décider de l’avenir de la ferme. Qui pour reprendre les terres, les machines et le réseau de débouchés ? Qui pour continuer à nourrir les personnes qui vivent sur ce territoire comme il l’a fait pendant toutes ces années ? Et comment s’assurer une retraite pas trop au ras des pâquerettes ?
D’un côté, un voisin agriculteur qui voudrait bien s’agrandir, convoite la terre pour augmenter sa production en céréales et aussi les aides de la PAC1 calculées en fonction du nombre d’hectares de l’exploitation. De l’autre, une jeune paysanne fraîchement diplômée qui souhaite s’installer en bio sur une petite ferme en polyculture élevage. Et puis il y a cette société agricole faisant partie d’une holding qui lorgne également sur les terres pour y installer une porcherie industrielle. Enfin, parmi les candidats à la reprise, il y a aussi un fonds d’investissement qui a besoin d’acquérir des prairies et des bois pour valoriser ces puits de carbone qui intègreront les données de sa RSE2, la dédouanant au passage de ses pratiques néfastes pour l’environnement : en un mot, du green washing.
L’histoire ne racontera pas la suite de l’aventure. D’ailleurs elle est assez caricaturale, peut-être trop pour être vraie. Mais elle nous permet d’éclairer les enjeux de la transmission des fermes et les questions auxquelles peut être confronté un ou une paysanne qui doit passer la main.
Préserver les terres bio
Lorsqu’on a travaillé dur toute sa vie, qu’on a beaucoup investi sur la ferme et peu cotisé pour la retraite, on peut comprendre la tentation de céder au plus offrant. La réalité aujourd’hui, c’est qu’« une ferme sur quatre seulement est reprise, les autres partent à l’agrandissement » explique Jean-Paul Gabillard, maraîcher qui a fourni Scarabée pendant vingt-cinq ans et vient tout juste de transmettre la ferme familiale. L’agrandissement, c’est tout simplement l’achat de parcelles supplémentaires pour augmenter les surfaces d’une ferme existante. Or les études montrent une corrélation certaine entre agrandissement et usage de produits phytosanitaires.
L’exemple récent de la transmission de la ferme du Breil à Melesse a fait bondir les défenseuses et défenseurs de l’agriculture biologique paysanne. Cultivée en bio depuis quarante ans, la ferme du Breil doit passer la main. Quarante hectares de prairies et de céréales à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes. Pour reprendre le flambeau, quatre paysannes et paysans proposent un projet construit collectivement et patiemment, soutenu par plusieurs paysans bio du secteur, permettant l’installation de trois petites fermes. Après avoir elle aussi soutenu le projet, la Safer3 a soudainement décidé d’attribuer la majeure partie des terres à une ferme conventionnelle déjà existante sur le territoire, excluant de fait l’un des projets de nouvelle ferme bio.
Ce choix, effectué à bulletin secret, illustre à la fois le rôle crucial de la Safer comme outil de régulation du foncier agricole, mais aussi un manque de transparence et des collusions de plus en plus dénoncées avec la FNSEA. Vous savez, ce syndicat agricole productiviste et fervent défenseur de l’usage des engrais et pesticides qui a également ses entrées nombreuses au sein des Chambres d’agriculture et des conseils d’administration du Crédit agricole et a donné tout son soutien à la loi Duplomb.
Des fermes, pas des firmes
À l’autre bout de l’échiquier agricole, la réalité, c’est aussi que 10 % des terres agricoles françaises sont détenues par des sociétés à capital ouvert. C’est-à-dire des sociétés où ce sont les actionnaires – qui n’ont en réalité que peu de lien avec la terre – qui décident de leur allocation, les agriculteurs et agricultrices devenant des exécutant·es au service d’actionnaires recherchant avant tout le profit. « Il y a là un conflit avec les fonctions nourricières de la terre, dénonce Marie Le Berre, consultante et sociétaire de Scarabée. Ce système produit un effet de verrou très fort contre les petits producteurs familiaux. » Comment ne pas voir là l’accaparement des terres agricoles ?
C’est d’ailleurs ce que dénonçait en 2021 le rapport du député Sempastous consacré à la régulation du foncier agricole : « Le scénario actuellement à l’œuvre est bien celui d’un accaparement des terres au détriment de candidats à l’installation. » De fait, entre 2010 et 2016, le nombre d’exploitations agricoles individuelles a diminué de 19 % tandis que le nombre d’exploitations sociétaires n’a cessé de croître, parallèlement à l’agrandissement des fermes.
L’accaparement des terres agricoles, c’est évincer les paysannes et paysans de toute décision, c’est exclure les « petit·es ». C’est surtout mettre en péril notre souveraineté alimentaire telle que définie il y a trente ans par la Via Campesina et reconnue par la déclaration des Nations Unies de 2018 : non pas seulement la capacité des terres à produire mais la capacité des paysannes et paysans à décider de leur usage et de leurs méthodes, et le droit des personnes à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite de manière durable.
Terre de liens : un autre modèle agricole et alimentaire est possible
Créé en 2003, le mouvement Terre de liens poursuit le projet de libérer la terre de la spéculation. Au moyen de sa foncière, il veut favoriser l’accès à la terre en achetant des fermes grâce à l’épargne de citoyen·nes et d’institutions privées. Louées à des paysannes et paysans bio, les terres échappent à la concentration agricole et sont considérées comme un bien commun à haute valeur alimentaire, sociale et environnementale. Chaque année, la foncière fait l’acquisition d’une quarantaine de fermes. De leur côté, les dix-neuf associations réparties sur le territoire français accompagnent au plus près les projets agricoles en mettant en lien agricultrices et agriculteurs cédants avec les candidat·es à l’installation. Un outil précieux de transmission et d’installation de fermes paysannes à taille humaine.
Conserver des fermes à taille humaine
Entre 2010 et 2020, tandis que le nombre de fermes de moins de 50 hectares a diminué de près de 40 %, celui des fermes de plus de 200 hectares a plus que doublé. En dix ans, la taille moyenne des fermes a augmenté d’environ 25 %. Les chiffres sont éloquents. La tendance est à l’agrandissement des fermes. Et sur la première marche du podium, les grandes cultures de céréales. Corollaire de cette tendance : moins de haies et prairies permanentes donc moins de biodiversité, moins de fumier et plus d’engrais azotés – majoritairement importés – dont les excès sont transformés en nitrates avec les effets délétères que l’on connaît sur la qualité de l’eau. Sans parler des conséquences de l’usage des pesticides à la mode en grandes cultures céréalières ou maraîchères conventionnelles.
Et si l’on en croit la récente adoption de la loi Duplomb, qui, nonobstant la censure du retour de l’acétamipride par le Conseil constitutionnel, favorise l’agrandissement des exploitations et les mégabassines – autrement dit l’accaparement des terres et de l’eau – l’avenir n’est pas enthousiasmant.
Il y a un enjeu de souveraineté alimentaire et de santé publique à conserver des fermes à taille humaine.
Il y a un véritable enjeu de souveraineté alimentaire et de santé publique à conserver des fermes à taille humaine. Facile à dire, mais pas si évident à faire. Transmettre sa ferme, ce n’est pas simplement donner les clés du tracteur.
Transmettre sa ferme, ça s’anticipe
En Bretagne en 2020, un quart des fermes avaient à leur tête une personne de plus de soixante ans. Parmi elles, plus d’un tiers ne savaient pas ce que deviendrait leur ferme trois ans plus tard. C’est dire si la transmission ne semble pas être facile à questionner. On imagine bien que les paysannes et paysans sont plus préoccupé·es par leur quotidien, la nécessité de produire pour nourrir et se nourrir, la météo qui n’est pas toujours tendre et les aléas qui peuvent impacter fortement la production. Pourtant, toutes les structures d’accompagnement à la transmission estiment qu’il est nécessaire de se poser la question dix à cinq ans avant le départ envisagé.
« Anticiper la transmission, c’est un gage de réussite »
Émeline Jarnet, Civam 35 IT
Le Civam Installation transmission4 d’Ille-et-Vilaine a été créé il y a vingt ans par des paysannes et paysans. Il se donne pour mission d’assurer le renouvellement des générations en agriculture, en accompagnant la transmission des fermes et l’installation de nouvelles générations. Parmi les nombreuses actions qu’il mène, le porte-à-porte auprès des fermes permet de faire émerger l’idée qu’un jour il faudra transmettre. Et que chaque ferme est précieuse et peut être transmise à une personne ou un collectif qui serait prêt à reprendre le flambeau pour maintenir des campagnes vivantes et nourricières.
Un tourbillon de questions
Une fois que l’idée a germé, c’est un tourbillon de questions qui jaillit dans la tête du paysan ou de la paysanne à mesure que l’échéance approche. Combien vaut ma ferme ? Est-elle transmissible ? Comment céder la ferme mais rester propriétaire des terres ? Comment assurer la continuité des baux ? Comment être sûr·e que mes terres continuent d’être cultivées en bio ? Et comment garantir à la personne qui reprendra la ferme que les parcelles resteront des terres agricoles ? Où vais-je vivre si je quitte la maison du corps de ferme ? Au-delà des aspects techniques et juridiques, la spécificité du métier de paysan·ne est l’imbrication très forte entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis il y a l’attachement affectif. Il n’est pas si facile de se séparer de « sa » terre.
Pour aider à répondre à toutes ces questions, des structures comme le Civam, Agrobio 35 ou la Chambre d’agriculture organisent des temps d’échange et des accompagnements précieux.


Le Civam accompagne les projets de transmission
Émeline Jarnet vient de fêter ses vingt ans au sein du Civam 35 Installation Transmission. On peut dire que le milieu paysan bretilien, elle en connaît un bon morceau. C’est elle qui accompagne les projets de transmission de fermes en facilitant les liens entre les paysan·nes qui cèdent leur ferme et ceux et celles qui souhaitent s’installer. Nous l’avons rencontrée. Lire l’entretien.
Savoirs paysans
Les freins levés un à un, il s’agit de confier la clé des champs à une personne ou un collectif qui continuera à faire vivre la ferme, à sa manière. Alors on transmet des terres, des machines mais aussi des connaissances et des savoir-faire.
Et il faut imaginer et accepter que peut-être le ou la paysanne qui reprend la ferme fera évoluer les méthodes ou les cultures. Pour que la transmission puisse se faire sans douleur, la période de transition est précieuse. Il faut apprendre à se connaître pour créer un lien de confiance. Et puis l’expérience du terrain est la seule qui permette véritablement de connaître son sol, son climat, ses contraintes spécifiques. Comme le reconnaît Romain Lepage qui vient de s’installer sur la ferme historique des Gabillard à Saint-Grégoire, « paysan est un métier d’observation, ce n’est pas si simple à transmettre. »

Après une année de parrainage, Jean-Paul et Delphine Gabillard ont transmis leur ferme maraîchère à Romain Lepage.
Si reprendre la ferme familiale est, comme le dit Guy Collin, « un toboggan » pour son fils Jolan qui y a grandi et observé ses parents travailler chaque jour, pour les Gabillard, il a fallu chercher un peu pour trouver le bon repreneur. L’exemple de Jean-Paul et Delphine Gabillard, qui ont transmis vingt-cinq hectares de ferme maraîchère à Romain Lepage au printemps dernier, illustre bien ce passage de relais. Un système de parrainage leur a permis de travailler ensemble pendant une année.
Romain a appris à connaître le sol de ces champs, a lancé une expérimentation agronomique pour comparer les systèmes de couvert entre deux cultures, a récolté ses premières fèves, a fait ses erreurs aussi. Mais c’est comme ça qu’on apprend, dit avec philosophie Jean-Paul qui reconnaît qu’il a fallu « arriver à lâcher le morceau, prendre sur soi, le laisser faire ses erreurs. » Et de poursuivre : « On travaille tellement avec le vivant et le climat que des erreurs on en fait tout le temps. Ça fait partie du métier. »
« Ce qui était important c’était pouvoir transmettre la ferme dans son entièreté, en bio. Le bio c’était impératif. Ça fait trente ans qu’on est en bio. Hors de question que ça retourne en conventionnel. »
Delphine Gabillard
Au printemps dernier, Jean-Paul et Delphine ont laissé les clés à Romain, confiants, conscients qu’il fera grandir la ferme à sa manière : « Il prend la ferme comme elle est aujourd’hui mais il fera à sa sauce. Ça ne fait qu’évoluer une ferme. C’est normal. » dit Delphine.
Romain aussi est confiant, il reprend les cutures mais aussi les débouchés et même une place dans le réseau : « on commence à m’appeler Jean-Paul » dit-il dans un sourire. Alors les fidèles de Scarabée, les aficionados du marché des Lices et les enfants de la cantine continueront de manger les pommes de terre, les choux et les fèves de la ferme du Bas Val, et puis qui sait, peut-être un jour des carottes aussi.
- Politique agricole commune ↩︎
- Responsabilité sociétale des entreprises ↩︎
- La Safer, société d’aménagement foncier et d’établissement rural, est l’opérateur du foncier agricole qui peut intervenir lors des ventes de parcelles et décider de l’attribution des terres. ↩︎
- Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ↩︎